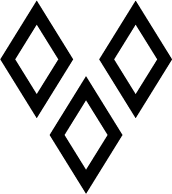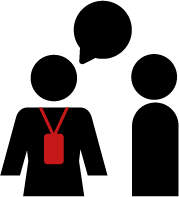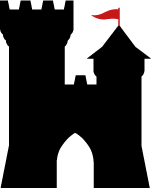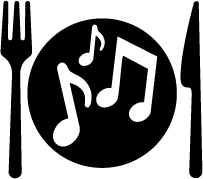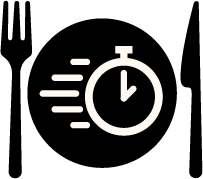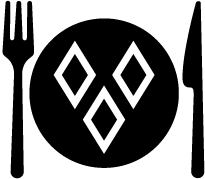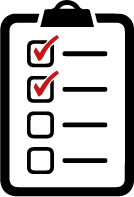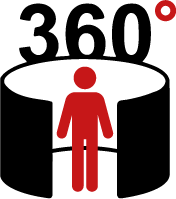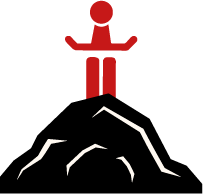Qui était Guenièvre, la femme du roi Arthur ?
Reine du royaume de Logres, épouse d'Arthur, fille du roi Léodagan de Carmélide... les titres attribués à Guenièvre sont d'autant plus nombreux qu'ils témoignent de son importance dans les textes du cycle arthurien. Particulièrement connue pour sa relation adultère avec Lancelot, l'un des chevaliers de la table ronde, qui était cette reine légendaire ?
Pour résumer aux plus jeunes :
Reine mythique de la légende arthurienne, Guenièvre est l'épouse du roi Arthur
Elle est connue pour sa relation adultère avec Lancelot
Elle est une figure médiévale de l'amour courtois
Souveraine puissante, elle est convoitée pour le royaume et le pouvoir qu'elle symbolise
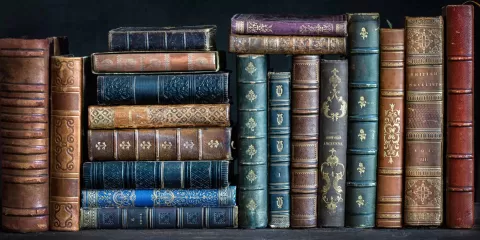
Quelle est l'histoire de Guenièvre ?
Si le personnage est présent dès les prémices de la légende arthurienne, il n'est développé qu'au XIIème siècle par l'auteur médiéval Chrétien de Troyes, référence de la littérature française sur le sujet. Epouse du roi Arthur, elle est devenue une figure emblématique du mythe.

De princesse de Carmélide à souveraine de Bretagne
Guenièvre est la fille de Léodagan, roi de Carmélide et ancien soutien d'Uther Pendragon, le père d'Arthur. Elle est dépeinte comme une femme d'une extrême beauté, répondant aux codes sociétaux médiévaux.
La rencontre entre Arthur et Guenièvre est détaillée dans le roman "Le Morte d'Arthur", écrit en 1469 par l'écrivain anglais Thomas Malory. Il y raconte que, lorsque le roi vit la princesse de Carmélide pour la première fois, alors qu’il présentait ses hommages à Léodagan, il en tomba éperdument amoureux. À tel point qu’il assura à Merlin l’enchanteur, son principal conseiller, qu’elle serait la seule femme qu’il épouserait. Le magicien aurait alors prédit qu’elle le trahirait avec un chevalier nommé Lancelot. Il l’épousa malgré cet avertissement et l’érigea au rang de reine de Bretagne.

Arthur, Guenièvre et Lancelot : un tragique triangle amoureux
Si l'amour que porte Guenièvre à son époux semble loin de la passion qu'il ressent, c'est de Lancelot qu'elle s'éprend au premier regard. Une passion réciproque qui doit rester secrète et les entraîne dans une relation adultère. Au début, ils restent suffisamment discrets pour échapper à tout soupçon, mais leur excès de confiance finit par les trahir. Tous les deux absents à un banquet, leur intimité ne fait plus l'ombre d'un doute pour certains membres de la cour d'Arthur, qui pressent leur roi d'agir. On cite régulièrement Agravain et Mordred (fils incestueux d'Arthur) comme ceux militant pour que le souverain condamne Guenièvre au bûcher.
Comment se termine l'histoire d'amour entre Lancelot et Guenièvre ?
Toujours aussi enamouré de sa femme, Arthur accepte de la condamner, uniquement parce qu'il est persuadé que Lancelot interviendra. Cela ne manque pas. Lancelot parvient à sauver la reine, mais, dans le combat, il tue les deux frères de Gauvain. Il est donc contraint d'abandonner Guenièvre et de s'enfuir pour la France. Gauvain pousse Arthur à le poursuivre et le roi laisse son épouse, amnistiée, à la garde de Mordred. C'est une terrible erreur puisque Mordred œuvre en secret contre le souverain du royaume de Logres, manipulé par la fée Morgane (ou Morgause selon les textes).

Comment Guenièvre finit-elle sa vie ?
Mordred, laissé gardien du château et de la souveraine, confie à Guenièvre son plan : tuer Arthur, récupérer le trône et l'épouser. C'est ici que les versions divergent. On lit parfois que Guenièvre accepte, d'autres fois qu'elle refuse et se réfugie dans un couvent. Quand Arthur apprend la trahison de Mordred, il revient l'affronter et périt de sa main lors de la bataille de Camlann, rendu vulnérable sans le fourreau d'Excalibur.
Veuve et accablée par les remords, Guenièvre aurait finit sa vie au couvent. Certains écrits relatent qu'elle aurait tout de même revu une unique fois Lancelot afin de sceller la fin de leur relation.

La reine Guenièvre : figure phare l'amour courtois
Les écrits de Chrétien de Troyes sont non seulement des références de la légende arthurienne, mais également dans la littérature courtoise française. Contrairement à d'autres auteurs de son époque, chez lui, les liens du mariage ne sont pas une barrière suffisante pour séparer deux amants.

Les codes d'une romance chevaleresque
Cette notion a éclos au XIIème siècle et s'est répandue jusqu'à la fin du XIIIème siècle. C'est une conception de l'amour est ancrée au modèle féodal et aux mœurs sociales de l'époque. Elle repose sur les valeurs chevaleresque qui font office d'idéal à atteindre :
Un sens de l'honneur irréprochable
Une place importante donnée à la parole et aux serments
Une politesse excessive, en toutes circonstances
La quête de l'amour parfait, appelé "fin'amor", qui place le sentiment au-dessus de toutes les lois sociales et religieuses
Profondément liée au modèle féodal, cette vision des relations amoureuses donne à la dame le rôle de suzeraine, tandis que le chevalier devient son vassal. Elle inverse ainsi les rapports habituels de pouvoir, l’homme se plaçant sous l’autorité de la femme qu’il désire. Dans les récits, la dame appartient souvent à un rang social plus élevé que le chevalier, ce qui permet de préserver ce jeu d’inégalité sans troubler l’ordre établi.

Lancelot et Guenièvre, la figure des amants idéaux ?
Si dans les premiers textes de Chrétien de Troyes le coup de foudre entre les deux amants est immédiat, il faut attendre "Lancelot ou le chevalier de la charrette" pour que la rencontre entre l'épouse d'Arthur et le chevalier ne change de version. Ici, pas de réciprocité. On confère à la reine Guenièvre une attitude presque hautaine lorsqu'elle est sauvée par Lancelot de l'emprise de Méléagant, qui l'a enlevée. Et pourtant, on pourrait s'attendre à davantage de gratitude puisque Lancelot du Lac est monté dans la charrette des condamnés pour pouvoir libérer l'épouse du roi Arthur, un acte humiliant pour un homme de son rang.
Ce roman, écrit ultérieurement, replace les dynamiques de l'amour courtois dès les prémices du premier contact entre ces deux personnages. Des dynamiques qui sont ensuite parfaitement respectée puisque la souveraine de Logres cède finalement au coup de foudre, n'hésitant pas à trahir Arthur malgré les liens sacrés qui les unissent.

Les enlèvements de Guenièvre : symboles de sa puissance ?
Nous venons de mentionner un autre point fondamental de la légende de Guenièvre : ses enlèvements. Méléagant, Melwas, Mordred... la souveraine est convoitée par bien des chevaliers. Et ce n'est pas anodin. Dans la plupart des versions, même quand elles ne détaillent pas son histoire, elle est enlevée ou séduite. D'après les spécialistes du cycle arthurien, Guenièvre n'est pas seulement l'archétype littéraire de la demoiselle en détresse, elle fait partie des reines symboles de souveraineté : en la possédant, on possède le royaume tout entier.
C'est le médiéviste Roger Sherman Louis qui fait un parallèle entre son enlèvement par Méléagant (ou par Melwas dans "La Vie de Gildas") avec le mythe de la déesse Perséphone des croyances grecques antiques. Selon lui, le ravisseur serait une personnification du mal, une créature surnaturelle symbolique qui règnerait, comme Hadès, sur un royaume infernal.
Que cette théorie soit véridique ou non, elle souligne l'importance de l'héroïne dans le monde celtique et surtout la cour du roi Arthur. S'emparer d'elle, c'est s'emparer de la couronne. Elle devient encore plus puissante que l'épée des rois.
Souveraine emblématique de Bretagne et épouse mythique du détenteur d'Excalibur, Guenièvre est un personnage complexe, que l'on dépeint tantôt comme une dame opportuniste et faible, tantôt comme une figure puissante. L'esprit de chevalerie de Lancelot est mis à mal par les puissants sentiments qu'elle lui inspire et leur romance va jusqu'à transcender les engagements que Guenièvre a pris devant les dieux en épousant Arthur. Elle est non seulement une héroïne intrigante, mais aussi une incarnation des valeurs de la romance chevaleresque, dont le mythe de Tristan et Iseult est également devenu une référence.